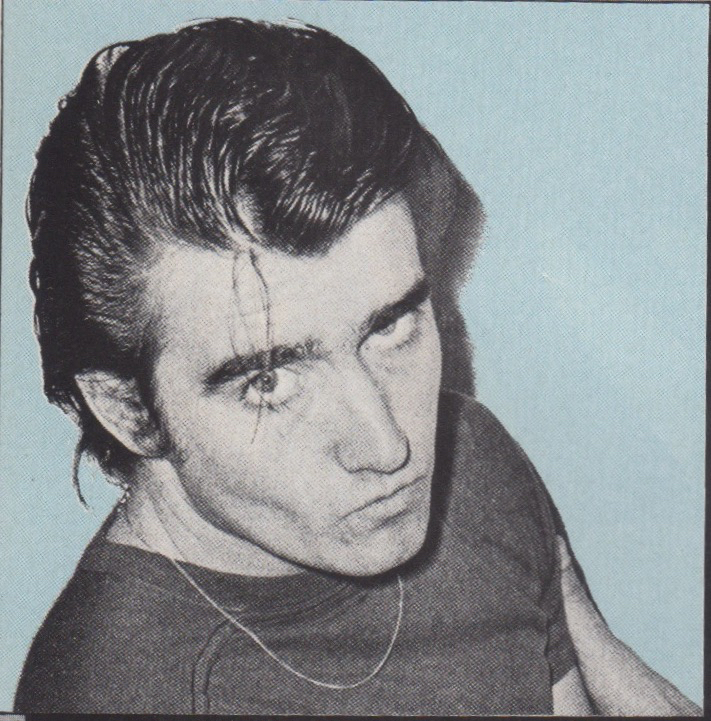BECOMING LED ZEPPELIN
 Décidément, le rock a la cote au cinéma en ce moment. On avait déjà adoré le biopic « A Complete Unknown », on est resté scotchés hier soir devant « Becoming Led Zeppelin ». Le doc prodigieux de Bernard MacMahon documente de manière incroyablement bluffante la naissance puis l’envol de Led Zeppelin. C’est la première fois de son histoire que Led Zep accepte de participer à un tel projet. Et on les comprend ! Riche de documents inédits de l’époque et structuré d’entretiens avec les membres du groupe y compris John Bonham décédé, qui intervient grâce à une interview audio inédite, les 121 minutes du doc filent à la vitesse de la lumière jusqu’à l’apothéose du show du 9 janvier 70 au Royal Albert Hall, lorsque Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham, fort de leur puissance de feu de virtuoses du rock, deviennent le premier groupe du monde, distançant même au sommet des charts l’ « Abbey Road » des Beatles avec leur « Led Zeppelin II », devenant ainsi enfin prophètes en leur pays et dans le monde entier après avoir d’abord enflammé les stades US.
Décidément, le rock a la cote au cinéma en ce moment. On avait déjà adoré le biopic « A Complete Unknown », on est resté scotchés hier soir devant « Becoming Led Zeppelin ». Le doc prodigieux de Bernard MacMahon documente de manière incroyablement bluffante la naissance puis l’envol de Led Zeppelin. C’est la première fois de son histoire que Led Zep accepte de participer à un tel projet. Et on les comprend ! Riche de documents inédits de l’époque et structuré d’entretiens avec les membres du groupe y compris John Bonham décédé, qui intervient grâce à une interview audio inédite, les 121 minutes du doc filent à la vitesse de la lumière jusqu’à l’apothéose du show du 9 janvier 70 au Royal Albert Hall, lorsque Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham, fort de leur puissance de feu de virtuoses du rock, deviennent le premier groupe du monde, distançant même au sommet des charts l’ « Abbey Road » des Beatles avec leur « Led Zeppelin II », devenant ainsi enfin prophètes en leur pays et dans le monde entier après avoir d’abord enflammé les stades US.
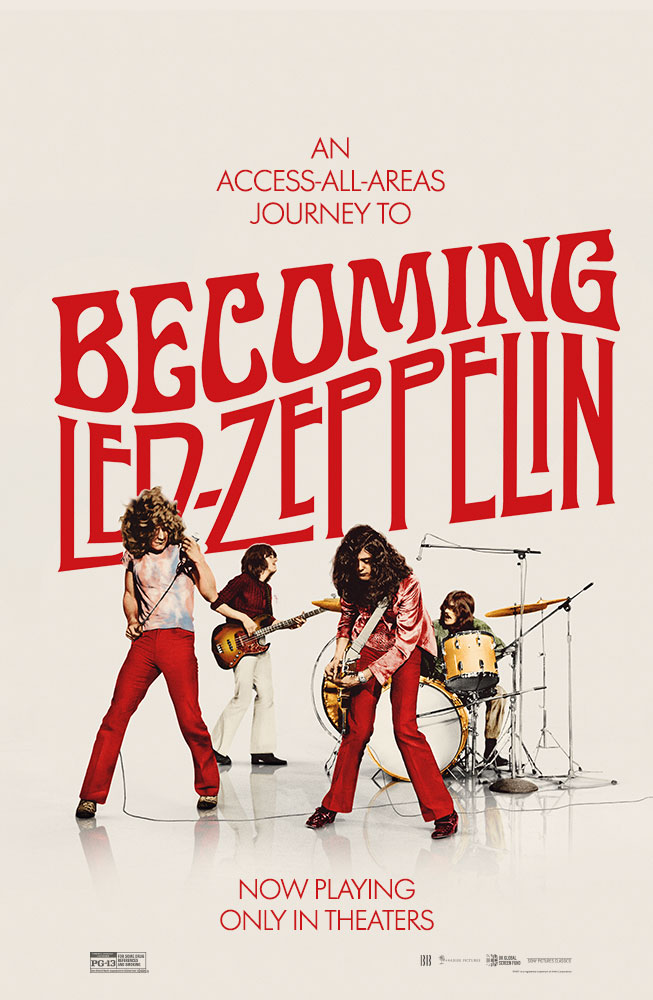 Après le tabac de « A Complete Unknown » ( Voir sur Gonzomusic TIMOTHÉE CHALAMET ROCK AND ROLL STAR et aussi A COMPLETE UNKNOWN ), avec « Becoming Led Zeppelin », on peut dire que ce printemps les aficionados du rock sont au 7ème ciel. Et comment en serait-il autrement avec cet époustouflant documentaire d’une rare qualité ? Pour en avoir réalisé moi-même un paquet dans les 80/90’s je connais bien le problème des docs musicaux, notamment diffusés sur Arte. Le hic c’est le budget. Une archive coute 1000 euros minimum et souvent plus chaque pour chaque minute entamée, par conséquent de trop nombreux docs marchent à l’économie, remplaçant les chères archives par du bla bla filmé aujourd’hui. Alors quand le bla bla est assuré par Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et la voix du regretté John Bonham, c’est non seulement parfaitement légitime mais surtout passionnant. Hélas, le plus souvent, dans les docs radins un 52 minutes ne contient en général que moins de trente minutes d’archives bluffantes et le reste c’est de la tchatche. Le pire, c’est quand ladite demi-heure de tchatche n’émane pas des acteurs directs, mais le plus souvent de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme…. Juste pour économiser du blé. C’est insupportable. Le film de Bernard MacMahon, à des années-lumière de ces pratiques, échappe bien entendu totalement à cette mercantile fatalité. Là on est sur du lourd, du très lourd… ce qui n’est guère surprenant en ce qui concerne Led Zeppelin. Durant 121 excitantes minutes, le film nous retrace toute la Genèse de ce groupe hors-normes formé de quatre musiciens, chacun killer dans son domaine, créateurs d’un des plus enivrants cocktail de blues rock et de folie psychédélique, un groupe pionnier qui n’a jamais cessé d’expérimenter en intégrant les plus improbables musiques du monde à l’instar des gnaouas ou de la musique indienne.
Après le tabac de « A Complete Unknown » ( Voir sur Gonzomusic TIMOTHÉE CHALAMET ROCK AND ROLL STAR et aussi A COMPLETE UNKNOWN ), avec « Becoming Led Zeppelin », on peut dire que ce printemps les aficionados du rock sont au 7ème ciel. Et comment en serait-il autrement avec cet époustouflant documentaire d’une rare qualité ? Pour en avoir réalisé moi-même un paquet dans les 80/90’s je connais bien le problème des docs musicaux, notamment diffusés sur Arte. Le hic c’est le budget. Une archive coute 1000 euros minimum et souvent plus chaque pour chaque minute entamée, par conséquent de trop nombreux docs marchent à l’économie, remplaçant les chères archives par du bla bla filmé aujourd’hui. Alors quand le bla bla est assuré par Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et la voix du regretté John Bonham, c’est non seulement parfaitement légitime mais surtout passionnant. Hélas, le plus souvent, dans les docs radins un 52 minutes ne contient en général que moins de trente minutes d’archives bluffantes et le reste c’est de la tchatche. Le pire, c’est quand ladite demi-heure de tchatche n’émane pas des acteurs directs, mais le plus souvent de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme…. Juste pour économiser du blé. C’est insupportable. Le film de Bernard MacMahon, à des années-lumière de ces pratiques, échappe bien entendu totalement à cette mercantile fatalité. Là on est sur du lourd, du très lourd… ce qui n’est guère surprenant en ce qui concerne Led Zeppelin. Durant 121 excitantes minutes, le film nous retrace toute la Genèse de ce groupe hors-normes formé de quatre musiciens, chacun killer dans son domaine, créateurs d’un des plus enivrants cocktail de blues rock et de folie psychédélique, un groupe pionnier qui n’a jamais cessé d’expérimenter en intégrant les plus improbables musiques du monde à l’instar des gnaouas ou de la musique indienne.
 Des images d’archives à foisons nous montrent leur enfance dans cette Angleterre de l’après-guerre dont les stigmates de terribles destructions et les rationnements sont encore bien présents dans le quotidien des petits londoniens. Premiers émois musicaux, on découvre que Jimmy Page passait déjà sur la BBC à 13 piges et qu’à 14 ans était déjà chef de chœurs organiste de sa paroisse et que c’est avec cet argent durement gagné qu’il a financé l’achat de sa fameuse Fender Telecaster. À cette époque, en 56/57 la musique en vogue en Angleterre est le skiffle, sorte de punk folk qui va changer à jamais sa manière de jouer de la guitare. Passé 16 ans, il est déjà dans le circuit des musicos semi-pros et enchaine les gigs au Marquee avec, entre autres, Eric Clapton et Jeff Beck. Page va ensuite multiplier les sessions avec des groupes de plus en plus fameux dont les Who et les Kinks. Page joue sur le tout premier single des Who « I Can’t Explain », début d’une longue amitié avec Keith Moon… qui sera quelques années plus tard « l’inventeur » du patronyme Led Zeppelin. Il joue aussi derrière les Stones, David Bowie et même Johnny Hallyday. Dans le doc on découvre que sur le fameux « Goldfinger » de John Barry c’est non seulement la guitare de Page qu’on entend derrière Shirley Bassey, mais aussi la basse de John Paul Jones. Pareil pour « Sunshine Superman » de Donovan… c’est sans fin, tant Jimmy Page a su se rendre indispensable à toute la British invasion. Mais tout allait changer en 64 lorsqu’il remplace Paul Samwell-Smith au sein des Yardbirds. De son côté, Robert Plant originaire de la province était destiné par sa famille à devenir comptable. Inutile de vous dire que le destin en a décidé autrement, lorsqu’il tombe dans le blues psychè, un peu comme Obelix dans son chaudron de potion magique. Et l’on apprend que le chanteur aux vocalises stratosphériques était homeless jusqu’à l’époque de son groupe Band of Joy.
Des images d’archives à foisons nous montrent leur enfance dans cette Angleterre de l’après-guerre dont les stigmates de terribles destructions et les rationnements sont encore bien présents dans le quotidien des petits londoniens. Premiers émois musicaux, on découvre que Jimmy Page passait déjà sur la BBC à 13 piges et qu’à 14 ans était déjà chef de chœurs organiste de sa paroisse et que c’est avec cet argent durement gagné qu’il a financé l’achat de sa fameuse Fender Telecaster. À cette époque, en 56/57 la musique en vogue en Angleterre est le skiffle, sorte de punk folk qui va changer à jamais sa manière de jouer de la guitare. Passé 16 ans, il est déjà dans le circuit des musicos semi-pros et enchaine les gigs au Marquee avec, entre autres, Eric Clapton et Jeff Beck. Page va ensuite multiplier les sessions avec des groupes de plus en plus fameux dont les Who et les Kinks. Page joue sur le tout premier single des Who « I Can’t Explain », début d’une longue amitié avec Keith Moon… qui sera quelques années plus tard « l’inventeur » du patronyme Led Zeppelin. Il joue aussi derrière les Stones, David Bowie et même Johnny Hallyday. Dans le doc on découvre que sur le fameux « Goldfinger » de John Barry c’est non seulement la guitare de Page qu’on entend derrière Shirley Bassey, mais aussi la basse de John Paul Jones. Pareil pour « Sunshine Superman » de Donovan… c’est sans fin, tant Jimmy Page a su se rendre indispensable à toute la British invasion. Mais tout allait changer en 64 lorsqu’il remplace Paul Samwell-Smith au sein des Yardbirds. De son côté, Robert Plant originaire de la province était destiné par sa famille à devenir comptable. Inutile de vous dire que le destin en a décidé autrement, lorsqu’il tombe dans le blues psychè, un peu comme Obelix dans son chaudron de potion magique. Et l’on apprend que le chanteur aux vocalises stratosphériques était homeless jusqu’à l’époque de son groupe Band of Joy.
 Lorsque Jimmy Page reprend en main les Yardbirds après tous les départs successifs dont Jeff Beck et Eric Clapton, son choix se porte sur ce chanteur hors normes. Jimmy Page avait l’habitude de maitriser la production en studio et les arrangements, il complète son casting idéal avec le bassiste hors-pair John Paul Jones, qu’il avait appris à apprécier au fil des sessions en studio et enfin avec un batteur juste monstrueux John Bonham… qui était justement le batteur du Band Of Joy de Plant. Les quatre se retrouvent dans un studio pourave de Gerrard Street à Londres et enregistrent le classique blues « Train Kept A-Rollin’ » popularisé façon rockabilly par Johnny Burnette. Et la mayo prend de chez prend ! Par conséquent, sous le patronyme de New Yardbirds le quatuor part en tournée en Scandinavie et les images du concert au Danemark sont d’une puissance qui balaie tout sur son passage : blues déchiré aux riffs en folie de distorsions, un effet accentué par l’utilisation d’un archet de violon plaqué sur les cordes de la guitare de Jimmy, la voix de Plant qui monte et descend dans les tours, le vrombissement ultrasonique de la basse de John Paul Jones et le roulement du beat de la batterie de John Bonham, comme un tonnerre grondant, mon tout formant un blues rock destroy, qui laisse le public sans voix. C’est dingue, mais on le voit dans le film, des gamins se bouchent les oreilles, des bourgeoises ont l’air coincée comme si une gaine imaginaire les empêchait de respirer tellement elles sont choquées. Mais nous, heureux spectateurs, on assiste en direct à l’accouchement de Led Zep et c‘est une sensation aussi dingue que grisante. Les images nous accompagnent pour que nous puissions vivre toute le maëlstrom de leur première tournée. À leur retour, sous la direction artistique de Page, le premier album est enregistré et auto-produit à l’Olympic studio de londres. Grace à leur manager, l’imposant Peter Grant, que Jimmy côtoie depuis des années, ils signent directement avec Jerry Dexler et son label Atlantic le contrat du groupe, garantissant ainsi que nul ne puisse intervenir dans le processus créatif de Led Zeppelin, une liberté inédite pour un groupe à l’aube des 70’s. On réalise ainsi tout le travail accompli. Le reste appartient à l’histoire du rock, Led Zep montant au Panthéon des formations les plus mythiques du genre, et ce super documentaire, à découvrir à tout prix au cinéma, le démontre de la manière la plus vibrante et aussi forcément assourdissante.
Lorsque Jimmy Page reprend en main les Yardbirds après tous les départs successifs dont Jeff Beck et Eric Clapton, son choix se porte sur ce chanteur hors normes. Jimmy Page avait l’habitude de maitriser la production en studio et les arrangements, il complète son casting idéal avec le bassiste hors-pair John Paul Jones, qu’il avait appris à apprécier au fil des sessions en studio et enfin avec un batteur juste monstrueux John Bonham… qui était justement le batteur du Band Of Joy de Plant. Les quatre se retrouvent dans un studio pourave de Gerrard Street à Londres et enregistrent le classique blues « Train Kept A-Rollin’ » popularisé façon rockabilly par Johnny Burnette. Et la mayo prend de chez prend ! Par conséquent, sous le patronyme de New Yardbirds le quatuor part en tournée en Scandinavie et les images du concert au Danemark sont d’une puissance qui balaie tout sur son passage : blues déchiré aux riffs en folie de distorsions, un effet accentué par l’utilisation d’un archet de violon plaqué sur les cordes de la guitare de Jimmy, la voix de Plant qui monte et descend dans les tours, le vrombissement ultrasonique de la basse de John Paul Jones et le roulement du beat de la batterie de John Bonham, comme un tonnerre grondant, mon tout formant un blues rock destroy, qui laisse le public sans voix. C’est dingue, mais on le voit dans le film, des gamins se bouchent les oreilles, des bourgeoises ont l’air coincée comme si une gaine imaginaire les empêchait de respirer tellement elles sont choquées. Mais nous, heureux spectateurs, on assiste en direct à l’accouchement de Led Zep et c‘est une sensation aussi dingue que grisante. Les images nous accompagnent pour que nous puissions vivre toute le maëlstrom de leur première tournée. À leur retour, sous la direction artistique de Page, le premier album est enregistré et auto-produit à l’Olympic studio de londres. Grace à leur manager, l’imposant Peter Grant, que Jimmy côtoie depuis des années, ils signent directement avec Jerry Dexler et son label Atlantic le contrat du groupe, garantissant ainsi que nul ne puisse intervenir dans le processus créatif de Led Zeppelin, une liberté inédite pour un groupe à l’aube des 70’s. On réalise ainsi tout le travail accompli. Le reste appartient à l’histoire du rock, Led Zep montant au Panthéon des formations les plus mythiques du genre, et ce super documentaire, à découvrir à tout prix au cinéma, le démontre de la manière la plus vibrante et aussi forcément assourdissante.